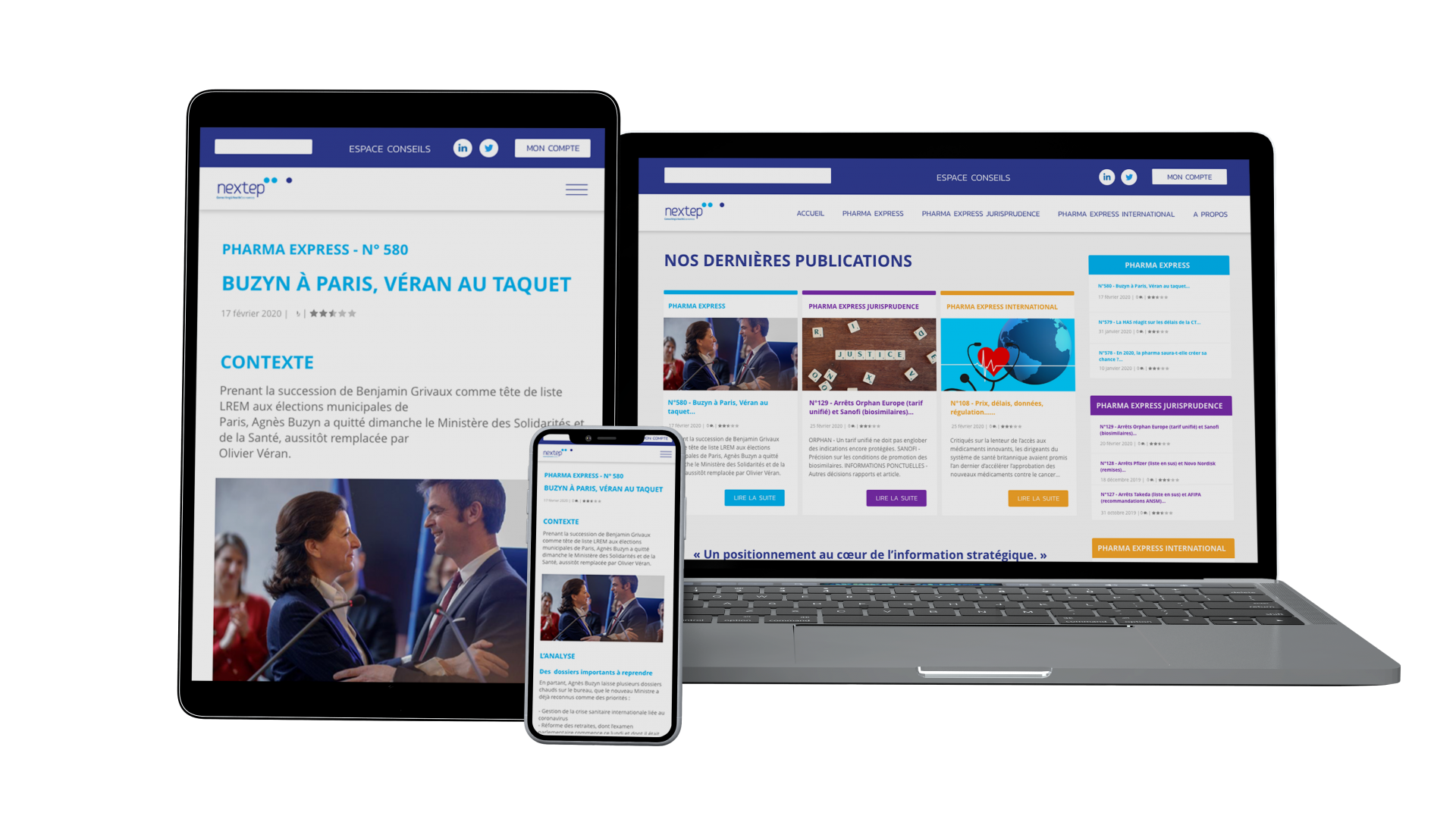« La clé est l’excellence scientifique, notamment dans la recherche fondamentale »
1. Quels types de partenariats conclut l’Institut Curie et quelle est le rôle de votre Direction ?
A.M. : « Tout d’abord, il faut rappeler que 3500 personnes travaillent à l’Institut Curie, dont 1300 personnes au centre de recherche. Il regroupe également un ensemble de 3 hôpitaux avec 2000 personnes. Et nous avons un statut de fondation privée à but non lucratif.
La Direction de la Valorisation et des Partenariats Industriels couvre l’ensemble de l’institution. Sous l’appellation de valorisation (« tech transfert » en anglais), elle est chargée d’identifier tout ce qui peut constituer une découverte transférable à un partenaire industriel pour le développer. Il s’agit ainsi de pointer ce qui est innovant et de le protéger, en initiant notamment la partie gestion de la propriété intellectuelle en déposant les brevets, y compris pour le compte de nos cotutelles et partenaires académiques (INSERM, CNRS, INRIa, Mines).
Cela dit, l’objectif des brevets n’est pas de les accumuler comme des trophées mais d’en faire quelque chose, via des contrats de licence, soit à travers des sociétés déjà existantes soit en créant des spin-off. Ainsi, dans le cadre du pôle start-up que j’ai mis en place il y a 2 ans, deux start-ups ont par exemple été créées en 2018 en immuno-oncologie, sur la base de brevets déposés par des chercheurs de l’Institut.
Un autre volet important de notre activité réside dans les partenariats avec les entreprises, qui ne sont d’ailleurs pas toujours des industriels. Nous avons la particularité d’être labellisé « Institut Carnot ». Nous pratiquons de la recherche partenariale, avec des contrats de gré à gré, sous couvert d’un programme scientifique et des objectifs communs. Parfois, il existe déjà un point de départ, avec un titre de propriété intellectuelle. Mais, souvent, il y a juste l’idée d’un chercheur qui rencontre le souhait d’une entreprise de travailler sur ce sujet.
Pour donner quelques chiffres, l’an dernier, nous avons signé 47 contrats de R&D, pour 6 millions d’euros (sans compter la recherche clinique). Cela requiert un véritable travail de professionnalisation des équipes : cadre juridique, contrats, programme de travail, prospects à aller chercher, etc. »
2. Justement, comment identifiez-vous et démarchez-vous vos partenaires ?
A.M. : « La clé est l’excellence scientifique, notamment dans la recherche fondamentale. Les entreprises viennent chercher le fait de penser la recherche de manière disruptive. Quand on dispose d’une vingtaine d’ERC (programmes financés par l’UE, les plus prestigieux), de quelqu’un comme Raphael Rodriguez qui a obtenu un des plus hauts prix en chimie, de publications dans Nature, Sciences, etc., cela nous positionne idéalement et les entreprises viennent spontanément. Par ailleurs, une fois que l’on est en partenariat, la collaboration a souvent tendance à s’étendre.
Sinon, nous avons une équipe d’une quinzaine de personnes, dont la moitié sont des chargés d’affaires sur des thématiques spécifiques (immunologie, chimie, data…). Chacun a pour objectif d’identifier de nouvelles entreprises avec lesquelles il serait possible de travailler. Il existe un véritable programme de marketing stratégique en interne. Toutefois, cela ne doit pas venir orienter la stratégie scientifique ou les objectifs médicaux mais le contraire. »
3. Ces contrats prennent-ils plutôt la forme de commandes ?
A.M. : « Ce ne sont surtout pas des commandes mais véritablement des partenariats. Cela commence par la définition du programme scientifique commun, la question qui va nous intéresser des deux côtés. Sinon, on tombe dans une approche de prestation de service ou de recherche. Il en va aussi de l’intérêt et de la motivation des chercheurs et c’est d’ailleurs un facteur clé de succès de nos projets. »
4. Si vos partenaires ne sont pas forcément des industriels, de quel type sont-ils ?
A.M : « Nous travaillons encore énormément avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Mais il y a eu une stratégie de désinvestissement de leur part dans la phase amont de la recherche et, aujourd’hui, on trouve davantage de petites biotechs et medtech à ce stade.
Par ailleurs, il existe de nombreuses entreprises avec lesquelles nous n’avions pas l’habitude de collaborer, notamment dans le data et le numérique, des sociétés importantes qui ont envie d’investiguer le domaine de la santé. Cela peut porter sur de l’analyse de génome, du machine learning… pour accélérer l’analyse de séquence et l’interprétation de résultats. Pour donner un exemple, nous sommes le deuxième centre au monde à avoir signé un accord avec Intel.»
5. Est-ce que vous voyez l’émergence de ces nouveaux acteurs comme une tendance durable ou de simples coups d’opportunité ?
A.M : « A mon sens, il s’agit d’un mouvement de fond. Certes, il ne s’agit pas intrinsèquement d’innovation thérapeutique dans l’IA mais de l’essor d’outils formidables, pour réaliser des choses qui étaient impossibles techniquement il y a quelques années.
Une des problématiques majeures de la R&D est le coût des essais cliniques. Or, s’ouvre la possibilité de faire des essais sur des cohortes virtuelles, afin de réduire le champ de la question que l’on pose et donc aller plus vite et à moindre coût. Aujourd’hui plus qu’avant, beaucoup de molécules ciblent les mêmes protéines ; ce qui implique de pouvoir pratiquer des analyses de plus en plus complexes. Par ailleurs, la plupart des actes nécessitent une radio, un généticien… Faire tourner des machines peut permettre de gagner du temps et des ressources au départ.
De manière générale, les entreprises de l’IT ont l’habitude de travailler sur tout ce qui est données de masse qui peuvent, dans la santé, aider au diagnostic et à la prescription. Par contre, je ne crois pas une seconde que les GAFA deviendront les compagnies pharmaceutiques de demain. Il faut un savoir-faire spécifique pour développer un médicament et c’est un marché extrêmement complexe. Mais ces acteurs peuvent s’avérer complémentaires et apporter beaucoup. »
6. Et quels types de relations avez-vous avec l’industrie plus « classique » ?
A.M : « En soi, le modèle classique n’a pas changé. Un des éléments qui conditionnent tout, c’est la recherche clinique. Quelle que soit la pathologie, il s’agit d’abord de sujets médicaux, avant d’être des sujets de paillasse. La médecine a toujours avancé avec des médecins chercheurs, des comparaisons entre alternatives et, de plus en plus, l’implication des patients.
Or, le dernier rapport du LEEM confirme que la France est en perte de vitesse, même s’il y a des espérances par rapport à certaines décisions qui pourraient permettre de corriger le tir. Mais, à cette heure, nous nous sommes notamment fait dépasser par l’Espagne, alors que la situation de leurs hôpitaux est loin d’être positive. Et, à l’Institut Curie, nous constatons de plus en plus que les patients qui bénéficient de molécules en pré-clinique sont d’abord en Belgique. Le premier patient français arrive, lui, 6 mois ou 1 an après. Ce déclin progressif commence même à toucher le secteur d’excellence de la cancérologie (1 étude sur 5 dans le monde), qui représente 80% de la recherche clinique en France.
La bonne nouvelle, c’est que cela commence à réagir et à bouger. Le CSIS de juillet 2018 a été d’une très bonne tenue. Il a été très objectif sur la recherche clinique, notamment en termes de délais car 7 mois, comme actuellement, c’est beaucoup trop. La Loi pour réformer le tirage au sort est en passe d’être votée, pour aménager ce qui était devenu une usine à gaz handicapante. Par ailleurs, l’ANSM a fait des gros efforts mais cela reste très long et compliqué en termes d’accueil et de gestion de l’innovation, surtout pour les dispositifs qui ne rentrent pas dans les cases. Avec les hôpitaux un peu exsangues qui ont du mal à intégrer les patients dans les temps et les industriels qui n’ont pas forcément les bonnes équipes, les délais deviennent inadmissibles ; inadmissibles surtout pour les malades. Et le pire, c’est quand il existe déjà des résultats aux Etats-Unis et qu’il n’est pas possible de lancer d’essai en France. Or, il faut rappeler qu’il s’agit du premier accès à l’innovation et que cela permet parfois tout simplement de sauver des gens (ex : AZT, anti-PD1). Derrière, il y a aussi d’importants investissements des hôpitaux, qui risquent de péricliter sans essais, ce qui rejaillira sur leur rentabilité… C’est un véritable cercle vicieux.
Il faut prendre conscience qu’il s’agit d’un véritable enjeu d’attractivité et de souveraineté nationale. Quand des laboratoires internationaux viennent s’implanter en Europe, ils vont là où les choses se passent facilement. En pratique, c’est l’Allemagne qui tient la pole ; le Royaume-Uni étant un peu en stand-by avec le Brexit. Mais, clairement, pour nous Français, il est plus compliqué de convaincre les décideurs. »
7. Qu’est-ce qui a fait que la France a perdu du terrain ?
A.M : « Il y a un mouvement vers plus de sécurité, avec le principe de précaution qui a un peu pris le pas sur la logique d’innovation qui, par nature, doit accepter une certaine prise de risque. Cela dit, les autres pays ne sont pas liberticides ni suicidaires. Nous avons simplement de grosses machines administratives, avec des chaines de décision plus longues que dans des pays comme la Belgique où il y a en fait moins de moyens.
Nous sommes sur un modèle de santé très performant et, du coup, nous allons regarder scrupuleusement les produits qui doivent être pris en charge. Mais, pour les essais cliniques, c’est purement administratif et cela peut être corrigé. »
8. Quid de l’application du CSIS, que vous avez mentionné ?
A.M : « Il était important d’entendre le Premier Ministre annoncer que la France va respecter les normes européennes, en matière de délais. On peut imaginer qu’il va y avoir des mesures et il faut espérer qu’elles ne tarderont pas trop.
Par contre, on a tendance à ne parler que du médicament. Or, l’innovation est beaucoup plus fertile et dynamique dans le DM et les nouveaux outils qui vont utiliser les données. L’Etat ne sait pas très bien gérer ce domaine et les entreprises n’ont pas forcément les équipes dédiées pour enregistrer des dispositifs innovants. C’est un secteur qui doit se concentrer impérativement pour arriver à mutualiser et être plus efficace, à l’instar de la pharma il y a quelques années. »
9. Au niveau des partenariats, cela se ressent-il avec davantage de contrats avec ces acteurs ?
A.M : « Il existe effectivement un vrai mouvement sous-jacent autour des data et technologies médicales, avec d’immenses perspectives en termes de résultats. Je citerai l’exemple récent d’un petscan numérique faisant passer la durée d’un examen de 2h à 15 minutes. Mais il y a également toutes les techniques permettant de limiter l’utilisation de chimiothérapies avec simplement un test diagnostic. Ce sont des projets sur lesquels on travaille de plus en plus.
A l’avenir, il faut se dire qu’il n’y aura pas plus de remboursement. En quelque sorte, un nouveau produit va donc devoir prendre la place d’un produit existant. Il faudra trouver de nouveaux modèles économiques mais, finalement, l’innovation – y compris organisationnelle – n’apparaît que sous l’effet d’une certaine pression. »
*Propos recueillis par Guillaume Sublet